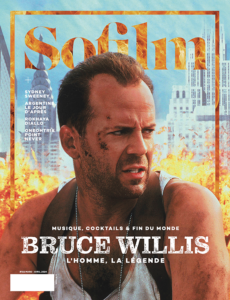Après l’échec de la superproduction Dune, dont le contrôle lui échappe progressivement, Lynch choisit de réaliser un scénario qu’il a déjà écrit. Il se concentre sur des éléments simples, sublimement déployés. Une oreille. Une chanson. Un masque à oxygène. Une histoire de bleu. Ce film-culte de 1986 devient aujourd’hui une fable magnifique sur la création.
Pour ceux qui connaissent Blue Velvet, il ne sert à rien de se demander si le film tient encore après le chef-d’œuvre qu’est Twin Peaks : The Return, ni même s’il mérite encore d’être vu. Il ne peut plus être celui que nous avons découvert adolescents comme il ne peut plus faire figure d’alliage unique et indépassable entre le blue du rêve et la boue de la pulsion. Accompagnons le film en repartant dans le passé : le nôtre, celui du spectateur ; celui de Lynch, qui pour la première fois éclaire son imaginaire en direction d’un public très élargi ; celui de Twin Peaks, dont Blue Velvet offre bien davantage qu’un brouillon : il est un premier voyage, une première rencontre.
En quelle année sommes-nous ?
1986.
Qu’est-il arrivé à Kyle MacLachlan ? Son visage lisse dans le rôle de Jeffrey Beaumont est d’une blancheur virginale. Il n’a pas la raideur de Cooper, ni la violence grotesque de Bad Coop. Il est au seuil de son existence.
Blue Velvet est le récit d’une initiation inachevée. Il faudra les trois saisons de
Twin Peaks pour qu’apparaisse pour Lynch quelque chose sur son visage, les traces d’une lente fatigue. Pareil pour Laura Dern. Qu’est-ce que son personnage de Sandy ici peut dire à sa Diane de
Twin Peaks ? Elle appartient à deux mondes absolument parallèles, qui vivent en s’ignorant complètement. Sandy, comme Jeffrey, est indéterminée, une page blanche sur laquelle
Blue Velvet n’écrira rien, tant elle reste au seuil de son désir. Tous les films de Lynch et de Dern racontent cet apprentissage du désir et du corps.
Sailor et Lula en est la découverte exaltée,
INLAND EMPIRE la face coupable et angoissée,
Twin Peaks : The Return les retrouvailles nostalgiques et adultes. Ici, rien n’arrive véritablement aux personnages comme aux acteurs.
Blue Velvet n’est pas tant une origine, qu’une porte devant laquelle Jeffrey et Sandy se tiennent avec Kyle et Laura : un pressentiment plus qu’un commencement.

En revanche, Laura Palmer est déjà là, et elle s’appelle Dorothy Vallens. Souffrante et inatteignable, humiliée et incorruptible, résistante et graciée, elle est là, masquée par la chevelure brune d’Isabella Rossellini, mais c’est bien elle. Elle ne ressuscite pas d’entre les morts, elle s’attache résolument à la vie, mais le spectateur reconnaît sa présence d’Eurydice. Une chose fondamentale a pourtant changé. Il ne s’agit plus d’une fille mais d’une mère. Certes, l’incarnation du mal qu’est Frank exige qu’elle l’appelle « Daddy » ; mais Dorothy a un fils et Jeffrey la regarde aussi, avec beaucoup d’ambiguïté, comme une mère. Le personnage de Dorothy reste attaché à un schéma œdipien, fait de honte et de tentation, d’inavouable et d’irrépressible. La dernière version de Laura Palmer, à la toute fin de The Return, est une meurtrière froide, autarcique, totalement seule.
Avec Blue Velvet, Lynch statufie encore la figure mythologique du Père freudien, qui domine toutes les hordes. Ce n’est qu’un premier pas pour le cinéaste. Tout l’enjeu de sa création est d’explorer la part cosmique du mal, de le libérer de sa gangue paternelle, de dissocier l’absolu du Mal et la petitesse du Père. Limité à un corps, il est souvent grotesque (Frank ici, Bob ou Leland plus tard). Le Mal n’est pas un corps, il est une lumière noire, un principe de défiguration qui excède les traces physiques. C’est le visage de Frank déformé par son masque à oxygène. Jean-Marie Samocki