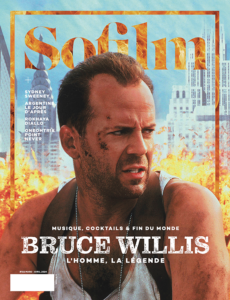VIVARIUM de Lorcan Finnegan
– En salles : VIVARIUM –
Un jeune couple passe la porte d’une agence immobilière. Face à un vendeur au sourire figé les deux se voient proposer d’aller faire un tour dans la maison de leurs rêves située dans un lotissement de banlieue. À partir de là, tout se met à ressembler à un épisode de La Quatrième Dimension. Pourtant, ce n’est pas du côté de la science-fiction que le premier long métrage de l’Irlandais Lorcan Finnegan prend place mais plutôt dans un endroit étrange, quelque part entre existentialisme, documentaire animalier et manifeste dénonçant les contours du cauchemar moderne.
Un long type, gominé, costume deux pièces de cadre supérieur se plie, puis se redresse. D’un geste nerveux, il réajuste ses petites lunettes rondes et chante avec une voix aussi blanche qu’hyper anxieuse : « And you may tell yourself. This is not my beautiful house (…) » Pour le reste, il exécute une chorégraphie entre le pantin désarticulé et le diablotin BCBG dont la boîte aurait comme des problèmes de ressorts. « And you may tell yourself. This is not my beautiful wife. » Le type se nomme David Byrne. Leader et théoricien des Talking Heads – groupe de rock new-yorkais ayant presque entièrement redéfini le langage punk pour le faire muer en new wave – il lutte contre l’époque. Pourquoi pense-t-on à l’ambiance du tube des Talking Heads, « Once in a Lifetime », en découvrant Vivarium ? Peut-être parce que ce film semble accroché au même flash existentiel et pessimiste que les héros new wave du début des années 1980. Le flash ? Celui qui questionne jusqu’à la fin des milliers de jeunes Occidentaux et qu’on pourrait résumer ainsi : « Fonder une famille heureuse dans une maison heureuse, n’est-ce pas ajouter encore un peu plus de confusion à ce qui ressemble au début de la fin ? »
Vrai conte cruel de la vie moderne, Vivarium est le genre de film dont le manque de budget a été transcendé par une inventivité formelle visible à chaque plan et qui s’inscrit très bien dans un courant de cinéma – malheureusement minoritaire –, où ce sont les hypothèses du futur qui disent le mieux la philosophie du présent. Leurs noms en vrac : THX 1138 de George Lucas, Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol, The Truman Show de Peter Weir et même, Under the Skin de Jonathan Glazer. À ces références, on peut ajouter une pincée de théâtre de l’absurde type Samuel Beckett et quelques situations à la Monty Python sans l’humour qui va avec. D’une voix timide, Lorcan Finnegan complète : « Oui, j’ai aussi entendu pas mal de fois la comparaison avec Black Mirror. Franchement, j’ai beaucoup de mal à me prononcer. Je ne suis pas à l’aise avec l’analyse de mes films. Je le vois plutôt comme un prototype pas toujours défini entre plein de choses qui m’intéressent. Il y a des emprunts au langage des spots publicitaires, très beaux et anxiogènes. J’ai travaillé dans ce domaine avant de passer à la fiction et je sais comment la société de consommation peut vendre des choses creuses à des gens existentiellement désarmés en les faisant passer pour authentiques. Sans doute qu’il y a aussi dans ce film un prolongement des photos de passants qu’il m’arrive de prendre, au hasard, dans les rues, à Dublin. C’est quelque chose que je fais au quotidien. À partir de ces clichés, je me mets à imaginer dans quel type d’habitat ces gens que je croise évoluent, quels sont leurs espérances, pour quoi seraient-ils prêts à se battre. Le hasard et la rêverie sont parfois les meilleurs alliés pour compléter une histoire. Le reste, c’est de la technique, de l’enthousiasme et de la persévérance. »

The Visit
Une façon de poser les équations les plus riches de la façon la plus simple qui soit également. Car Vivarium débute de façon banale. Avec les personnages les plus archétypaux qui soient. Ils s’appellent Gemma et Tom et forment un jeune couple rayonnant (les parfaits Imogen Poots et Jesse Eisenberg). Ils apparaîtront vite comme les parfaits cobayes à cette expérimentation jamais sans dégât qui s’appelle la vie adulte. Premier acte : Gemma et Tom s’aiment, projettent de fonder une famille, et, par conséquent, se disent qu’il faut devenir propriétaire de leur logement. Il n’y a aucun enjeu quand ils pénètrent dans une agence de quartier pour défricher le catalogue des maisons en vente. Aucun enjeu, d’accord, mais le maître des lieux réussit à harponner leur attention. Sans jamais se départir de son sourire figé, il récite, d’une voix fausse, tous les avantages à porter leur choix sur un nouveau programme immobilier situé en banlieue. « Voulez-vous que j’organise une visite ? » Deuxième acte : le couple réalise que la maison qu’on veut lui vendre a ses avantages (spacieuse, propre, moderne), mais aussi de sacrés inconvénients. D’abord, à part son numéro, rien ne la distingue des autres constructions du lotissement. Peut-être sont-ils encore trop jeunes pour sauter à pieds joints dans le conformisme. Peut-être ont-ils encore le choix. Ils en plaisantent. Troisième acte et premier d’une série de twists : l’agent immobilier s’est fait la malle en pleine visite. Impossible pour Gemma et Tom de quitter le labyrinthe aseptisé du lotissement, ni d’appeler à l’aide. Il va falloir non seulement composer avec les règles de cette grande baraque, mais également – pas prévu – veiller à l’éducation et à la survie d’un bébé tombé du ciel. Là encore aucune explication. Dès lors, que faire ? Deux choix : s’opposer à l’ordre des choses, vaille que vaille, ou attendre en faisant le dos rond de se vider de son énergie vitale. Animé de la curiosité bienveillante qu’ont parfois les laborantins pour leurs objets d’étude, Finnegan propose les deux scénarios. Pas pour rien que le cinéaste choisisse d’aller sur un terrain où on ne l’attend pas forcément : celui du documentaire animalier. « Vous savez, je me suis toujours passionné pour les documentaires que produisait Richard Attenborough pour la BBC. Ce sont des programmes que les familles britanniques regardent à la télé de façon, je dirais, routinière. En tout cas, ils ne font pas toujours le lien entre le règne animal et la vie des êtres humains. Un segment m’avait particulièrement fasciné. Il explore la vie des coucous européens, ces espèces qui ont l’habitude de pondre un œuf dans le nid d’un autre volatile. À mesure que les oisillons grandissent, ils privent les vrais occupants du nid de leur nourriture et même parfois de leur vie. C’est très particulier les coucous. Ils s’installent chez les autres comme s’ils étaient chez eux et, en fin de compte, ils les tuent. Ça me paraît une métaphore de la vie assez sensée, vous ne trouvez pas ? » Jean-Vic Chapus