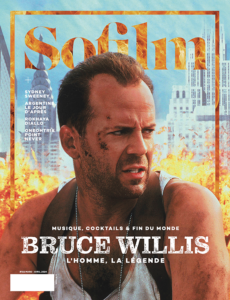LES OISEAUX DE PASSAGE de Ciro Guerra et Cristina Gallego
– LE FILM DE LA SEMAINE : LES OISEAUX DE PASSAGE –
Avec Les Oiseaux de passage, présenté à la Quinzaine des réalisateurs l'année dernière, les réalisateurs colombiens Cristina Gallego et Ciro Guerra plongent aux origines du narcotrafic dans leur pays. Au milieu des années soixante-dix, les indigènes Wayuu du nord du pays se lancent dans l’exportation de marijuana vers les États-Unis. Une manne financière qui va aiguiser les rivalités entre clans familiaux et détruire leur structure sociale.
Comment est-ce que vous êtes tombés sur les faits qui ont inspiré le scénario ?
Ciro Guerra : Cette période est connue sous le nom de Bonanza marimbera, une décennie (1975/1985) pendant laquelle des clans familiaux de la région de la Côte caraïbe se lancent dans le trafic de marijuana à destination des États-Unis. C'est une histoire qui fait presque partie des mythes populaires d’une région très proche de là d’où je viens. On avait tourné un film dans le département de Guarija en 2009, Les Voyages du vent et on a réalisé que les gens de la communauté indigène Wayuu en parlaient toujours. On s'est dit qu'il faudrait faire des recherches là-dessus et on a commencé à discuter avec des gens qui nous ont raconté cette histoire. C'est à partir de ces témoignages qu'on a écrit le film. Beaucoup d'articles ont été consacrés à cette époque mais tout a été occulté par l'histoire qui a suivi, celle des cartels, Escobar, Cali. Les plus jeunes générations n'en avaient pas entendu parler. Il n'y a que les gens de 50 ou 60 ans qui s'en souviennent.
Cristina Gallego: Personnellement, j’ai trouvé une résonance avec ma jeunesse dans les années 80 à Bogota. J'ai vu à côté de chez moi, certains de mes voisins, des amis de mes frères et sœurs, emprunter ces trajectoires du trafic et de la criminalité. J’ai vu leur ascension et leur chute. Ce qu’on ne savait pas, c’était comment le business de la drogue avait débuté dans cette région et comment il avait changé toutes les structures sociales de la société.
Ciro Guerra : C'est une histoire triste et tragique mais en même temps beaucoup de gens ont de bons souvenirs de cette époque. Ils s'en souviennent comme d'une grande fête, avec une importante croissance économique qu'ils n'avaient jamais connue. Donc pour eux cela fait plus ou moins figure d'un âge d'or disparu même s’ils ont perdu beaucoup de proches. Dans la région, tout le monde connaissait quelqu'un qui était impliqué, un cousin, un oncle ou un ami.
Au-delà du sujet évident, qu'est-ce qui en fait une bonne histoire ?
Ciro Guerra: Il y avait le potentiel pour un film de genre mais complètement différent. Cela réunissait tous les ingrédients d'un bon film de gangsters dans une communauté indigène, dans un environnement anthropologique où les femmes sont très puissantes. Par ailleurs, on y voyait aussi un mélange de western et de tragédie grecque moderne. Tout en étant, en un sens, une histoire à la García Márquez. Avant tout, nous voulions raconter l'impact du trafic de drogue sur la Colombie en prenant un angle à rebours de la célébration de la violence et de la glorification des criminels qu’on peut observer dans certains films.
Cristina Gallego: On y voyait aussi une métaphore assez juste de notre société ou de notre pays depuis plusieurs décennies. Nous vivons encore aujourd'hui avec les conséquences de cette guerre sans fin entre les rebelles et l'establishment, avec au milieu le business de la drogue, les relations entre les narcos et les paramilitaires, les gens du gouvernement… Cette situation est devenue la base de notre société. Ce n'est pas que le problème du narcotrafic, c'est plus compliqué que ça. C'est un besoin universel de pouvoir et d’argent. C'était aussi un exercice introspectif : apprendre à se connaître. On voulait faire un film avec eux pour apprendre de nous.
Ciro Guerra : Notre méthode de travail, ce n'est pas de faire des films sur des communautés mais avec les gens. On les a donc invités à participer à l'équipe du film. Ils représentaient à peu près 30 % des participants, devant et derrière la caméra.

Cela a été facile de les convaincre ?
Cristina Gallego: Non, mais quand on est arrivé pour mener nos recherches, les gens étaient heureux de nous raconter leur histoire. Ils avaient envie de la partager avec nous. On a pris contact avec un groupe qui travaille avec les Wayuu sur l'outil audiovisuel, et ils nous ont aidés à construire des ponts et des liens avec eux. Il fallait d'abord se rendre sur place et écouter, parce qu’ils restent méfiants, peu enclins à travailler avec les « Blancs » à cause des problèmes qu’ils rencontrent avec l’industrie minière sur leurs terres.
Ciro Guerra : À l’arrivée, ils étaient très heureux de collaborer. On leur a d’ailleurs projeté le film à la fin, la nuit dans le désert, avec le projecteur comme seule lumière. On avait prévu 500 sièges et finalement 2 000 personnes sont venues. Des familles, des seniors, des enfants. La culture des Wayuu ne repose pas ou très peu sur l'écrit, tout se transmet par l'oral et les chansons, donc c'est d'autant plus important pour eux de voir un moment de leur histoire représenté dans un film.
Qu’est-ce que vous avez vu de leur situation sociale, quarante ans après ?
Ciro Guerra: C'est une communauté qui est confrontée à beaucoup de problèmes sociaux. Ils ont dû se battre contre les sociétés minières qui se sont imposées sur le territoire et qui ont notamment dévié les sources d'eau, les rivières alors que c'est une terre très sèche où l'eau est essentielle. Ils ont subi une crise humanitaire il y a quelques années et ils doivent encore se battre face à un gouvernement corrompu. Mais c'est le peuple le plus résilient que j'aie jamais vu.
Cristina Gallego: La région où ils habitent est la plus riche du pays en ressources minérales mais aussi la plus pauvre en terme de revenu par habitant. Les enfants continuent de mourir de malnutrition à côté des plus grandes mines à ciel ouvert de charbon. C'était une région qui était protégée et qui ne l'est plus, donc on se retrouve avec les mêmes problèmes de déforestation qu'en Amazonie et les mêmes conséquences pour les populations indigènes.
Sur place, qu’est-ce qu’il reste de cette époque ?
Ciro Guerra : Dans le désert on peut encore voir les ruines de certaines de ces grandes maisons luxueuses qu’ils se sont fait construire à l’époque. Ils avaient invité des architectes italiens à venir construire des maisons dans un style rococo. La plupart ont été détruites quand les familles sont tombées dans la misère la plus complète. Certaines familles ont tout de même réussi à blanchir leur argent et maintenant elles font partie de cette classe politique très corrompue qui fait du mal à cette région.
Le personnage de Pablo Escobar et l’histoire des cartels des années 90 sont depuis quelques années largement exploités par l’industrie du cinéma et les séries. Est-ce que vous n’en avez pas assez de voir la Colombie réduite à cette période et à ces événements ?
Cristina Gallego: Oui, c’est un peu fatigant et c'était l'une des raisons pour lesquelles on voulait faire ce film. Toute cette période est représentée d'un point de vue extérieur, les autres racontent notre histoire. À chaque fois, on oublie que cela a détruit notre société. On voulait réagir à cette forme de kidnapping. Peut-être aussi que nous, Colombiens, ne sommes pas capables de regarder de manière honnête ces événements. Là, on a tenté de le faire avec ce film parce que du temps a passé. On peut évaluer les conséquences sur notre pays alors que l'histoire des cartels, les années 90 c'est peut-être un peu tôt. C'est toujours un tabou et un traumatisme collectif. Il faut du temps avant de s’y confronter.
Propos recueillis par Joachim Barbier